OIB
La revue juridique du bonheur
Revue Juridique du Bonheur n° 2025/7
Appel à contributions
Droit au bonheur et Vulnérabilités
Pour son prochain numéro, la Revue Juridique du Bonheur invite les chercheurs, universitaires et praticiens à soumettre un article pour son prochain numéro dont le dossier thématique sera consacré au thème "Droit au bonheur et Vulnérabilités".
Ce numéro, inscrit dans une approche pluridisciplinaire, met l'accent sur l'articulation entre le droit et les sciences humaines et sociales, englobant des domaines tels que les sciences politiques, la sociologie, l'économie, la philosophie, la psychologie, l'histoire ou encore l'anthropologie.
Cette thématique invite à réfléchir sur les interactions entre les fragilités humaines, sociales, environnementales ou institutionnelles et la quête de bien-être ou de bonheur, à la fois dans la théorie et dans les pratiques juridiques. Nous encourageons une réflexion approfondie sur la manière dont ces vulnérabilités façonnent et sont façonnées par le droit, tout en interrogeant les mécanismes juridiques à même de protéger le bonheur individuel et collectif.
Toute contribution sur une autre thématique est également la bienvenue.
Les contributions sont à envoyer au plus tard le 31 janvier 2026 à l'adresse suivante :
rjb@oib-france.com.
Pour plus de détails, voir l'appel à contributions.
Présentation
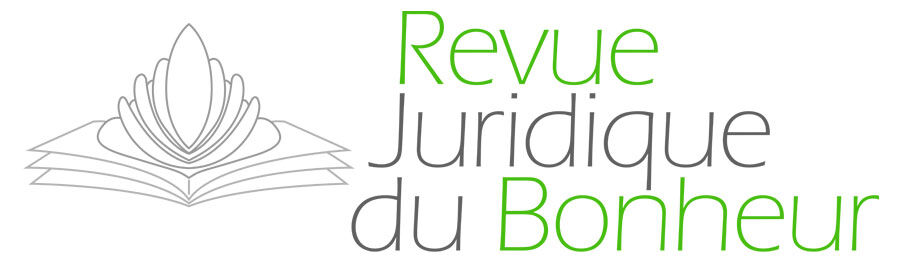
Le droit au bonheur émerge progressivement dans le paysage juridique, que ce soit au niveau international ou dans les droits nationaux. Formulé expressément ou sous d’autres vocables, ce droit émergent transparait dans nombre d’évolutions conventionnelles, constitutionnelles ou législatives.
De la mutation des indicateurs économiques à la reconnaissance pleine et entière d’un droit au bien-être, souvent lié à la notion de développement durable, la naissance de ce droit bouscule les traditions juridiques souvent ancrées dans des logiques de croissance économique. Il laisse entrevoir la prévalence de nouvelles priorités telles que le bien-être, l’équité sociale, la solidarité, les droits des générations futures ou encore la dignité humaine.
Dans ce cadre, la création d’une revue juridique dédiée au droit au bonheur est apparu comme le moyen de diffuser des solutions novatrices formulées par les instances internationales, nationales ou locales de par le monde, que ce soit par la voie réglementaire, législative, constitutionnelle, jurisprudentielle, coutumière ou encore sous la forme d’outils de soft law. Il permet aussi de mettre en exergue les obstacles à la reconnaissance d’un tel droit, d’un point de vue théorique comme empirique.
La démarche sous-jacente à la création de cette revue est d’inscrire le droit au bonheur dans le paysage scientifique pour en accréditer sa réalité et sa légitimité, pour témoigner de sa vitalité et de l’aspiration des sociétés contemporaines à exprimer une volonté de renouveler la perception du monde.
1. Champ d’application de la revue
Le champ couvert par la revue du droit au bonheur peut être défini tant d’un point de vue géographique que thématique ou encore linguistique.
1.1. Les échelles géographiques appréhendées
Le bonheur n’ayant pas de frontière, il y a lieu d’entendre largement le champ géographique de la revue. Les propositions d’articles pourront donc porter sur toute norme, que celle-ci émane d’une organisation internationale ou régionale, d’un État, d’une collectivité territoriale, d’autorités coutumières, voire même de personnes privées (entreprises, associations, ONG...). En effet, la décentralisation de la prise de décision s’inscrit totalement dans la démarche participative, qui constitue un vecteur parmi d’autres du droit au bonheur.
On le comprend, la revue juridique du bonheur a donc vocation à couvrir aussi bien des réflexions liées au droit international, au droit comparé, aux droits nationaux ou infra-nationaux.
1.2. Le champ thématique couvert
Le besoin d’une revue juridique traitant du bonheur parait évidente tant les notions de droit et de bonheur s’ignorent mutuellement.
La revue du droit au bonheur vise donc à combler ce vide pour hisser la science juridique comme artisan du bonheur et ce dans bien des branches du droit. En effet, le droit au bonheur doit être considéré comme un droit transversal qui dresse des ponts entre le droit privé et le droit public vers une finalité commune. Des démarches juridiques en faveur du bonheur peuvent en effet naître dans bien des domaines appartenant aussi bien droit privé (droit civil, droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit des sociétés, droit rural...) qu’au droit public (droits fondamentaux, droit constitutionnel, droit des finances publiques, droit de l’environnement, droit de l’urbanisme...). La revue accueille donc des contributions qui proviendront de domaines variés.
1.3. Langue
Novatrice et précurseuse, la Revue Juridique du Bonheur étant a priori encore la seule revue juridique entièrement consacrée au droit au bonheur, que ce soit en langue française ou en langue anglais ou espagnole. Ce constat conduit à ne pas limiter les articles à la langue française et à accueillir les articles en anglais comme en espagnol, la littérature juridique hispanique (notamment sud-américaine) étant particulièrement florissante à cet égard.
2. Organisation et fonctionnement de la revue
2.1. Le support
Afin de favoriser une accessibilité optimale, il a été fait le choix d’une revue en ligne, logiquement hébergée sur le site de l’OIB.
2.2. Fréquence
La fréquence de parution de la revue est aujourd’hui annuel. L’objectif étant à terme d’arriver à un rythme semestriel. Certaines rubriques seront alimentées au fil de l’eau (droit du vivant, droit des communs, ressources documentaires).
2.3. Rubriques
Comme toute revue, la revue du droit au bonheur est structurée en rubriques qui évoluent d’un numéro sur l’autre:dossier thématique, articles de fond (théoriques), retours d’expérience, chronique(s) d’actualité législative et/ou jurisprudentielle...
2.4. Comité de lecture/scientifique
Afin d’asseoir la crédibilité scientifique de la revue,celle-ci dispose d’une direction scientifique et d’une direction scientifique adjointe (junior) et d’un comité scientifique dont les membres seront issus des différentes branches du droit et originaires de plusieurs pays et qui soit composé à la fois d’universitaires et de praticiens du droit.
Numéros précédents
Comité éditorial de la revue

Annoussamy David
Juge honoraire de l'Inde
Carine David
Professeur de droit public
Yamouna David
Avocate Honoraire
Vincent Geronimi
Professeur en économie
Franck Laffaille
Professeur de droit public
Félicien Lemaire
Professeur de droit public
Jean-Pierre Marguénaud
Professeur de droit privé
Etienne Piaget
Doctorant en droit public
Eric Naim Gesbert
Professeur de droit public
Guylène Nicolas
Maitre de conférences (HDR) en droit public
Michel Prieur
Fondateur de la revue juridique de l'environnement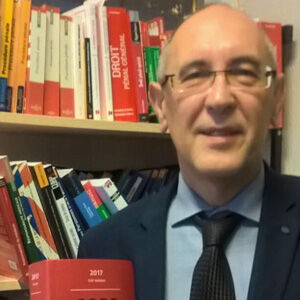
Bruno Py
Professeur de droit privé et sciences criminelles
Ornella Seigneury
Docteure en droit public
Marthe Stefanini Fatin Rouge
Directrice de Recherche en droit publicRecommandations aux auteurs
1. Soumission et évaluation d’une contribution
1.1. ENVOI DES PROPOSITIONS DE CONTRIBUTION
Les manuscrits doivent être envoyés en version électronique à l’adresse suivante : revuejuridiquedubonheur@oib-france.comIls peuvent être envoyés spontanément par les auteurs pour des publications hors dossiers, répondre à des appels à contribution publiés sur le site de la revue ou à des commandes. Toutes les soumissions suivent la même procédure d’évaluation et doivent être conformes aux recommandations définies dans le présent document.Le manuscrit ne doit pas excéder 60.000 signes (espaces compris) sauf dérogation. Les articles doivent être rédigés en français, en anglais ou en espagnol.Les textes et documents seront livrés aux formats Word pour les textes et les tableaux. Les fichiers originaux des illustrations devront être livrés, en même temps que le texte, au format JPG (à 300 dpi pour les photographies).
1.2. SÉLECTION DES CONTRIBUTIONS
La revue ne publie que des contributions originales qui n’ont pas fait l’objet de publication antérieures. Les articles envoyés dans leur intégralité sont évalués en aveugle par deux membres du comité éditorial. Si nécessaire, il est fait appel à des experts extérieurs. Les critères d’évaluation concernent le fond et la forme. La décision finale est prise par le directeur éditorial après avis des évaluateurs. Elle est transmise à l’auteur dans les meilleurs délais. Dans le cas des acceptations de publication avec corrections, l’auteur dispose d’un délai qui lui est notifié pour transmettre la version corrigée. Les soumissions acceptées pour publication sous réserve de modifications majeures peuvent faire l’objet d’une seconde évaluation interne. Le comité de rédaction se donne le droit de ne pas publier la soumission si les corrections requises n’ont pas été apportées.
1.3. CESSION DE DROITS
Les auteurs qui soumettent leurs articles à la revue acceptent de publier gratuitement leurs articles. Ils cèdent, à titre gratuit et non exclusif, les droits de diffusion papier et électronique qui permettent la diffusion libre et gratuite de la revue.Les auteurs conservent le droit de diffuser, selon les modalités de leurs choix, les articles publiés dans la revue à la seule condition, comme l’exige la législation, qu’apparaissent les références bibliographiques complètes, mentionnant la revue. Les auteurs peuvent notamment déposer la version publiée, en texte intégral, sur l’entrepôt universitaire de leur établissement.
2. Présentation de la contribution
2.1. POLICE DE CARACTÈRE
La police utilisée doit être le Times ou Times New Roman, taille 12.
L’italique doit être réservé aux mots étrangers et aux titres d’ouvrages ou de périodiques. Le gras doit être réservé pour les titres et sous-titres. Le soulignement est à proscrire.
2.2. STRUCTURATION DE LA CONTRIBUTION
Les textes doivent être structurés de la façon suivante :
- Titre
- Prénom Nom
- Affiliation ; fonction ; courriel ; site
- Résumé
- Mots-clés
- Titre traduit (en anglais et/ou en espagnol)
- Résumé traduit (en anglais et/ou en espagnol)
- Mots-clés traduits
- Introduction
- 1.
- 1.1.
- 1.1.1.
- 1.1.2.
- 1.2.
- 1.2.1.
- 1.2.2.
- 2.
- ....
- Conclusion
2.3. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Les références bibliographiques et autres doivent figurer dans les notes en bas de page. Une bibliographie doit être placée en fin de texte.
3. Bibliographie
Les références bibliographiques seront regroupées en fin de texte. Elles doivent inclure toutes les références mentionnées dans le texte.
Elles seront présentées selon les instructions suivantes :
3.1. LES OUVRAGES
Ouvrage individuel
Nom complet, initiales du prénom du premier auteur. et initiale du prénom. nom complet de l’auteur suivant (année). Titre en italique, Ville d’édition, Editeur, Collection.
- Prieur, M. (2014). Droit de l’environnement, Droit durable, Bruxelles, Bruylant.
Ouvrage collectif
Nom complet, initiales du prénom du premier directeur. & initiale du prénom. nom complet du directeur suivant (dir.) (année). Titre en italique, Ville d’édition, Editeur, Collection.
- Lemaire, F.(dir.) (2020). Penser et construire le bonheur : Regards croisés, Paris, Mare & Martin, Coll. Droit et Science Politique.
- Blaise, S., C. David et V. David(dir.)(2015). Le développement durable en Océanie, Vers une éthique nouvelle, Marseille, PU de Provence, Coll.Espace & Développement durable.
3.2. LES ARTICLES PARUS DANS DES REVUES
Article dans une revue papier
Nom complet, initiales du prénom du premier auteur. & initiale du prénom. nom complet de l’auteur suivant (année). « Titre de l’article », Nom de la revue en italique, volume (numéro de la revue) : pages.
• Naim Gesbert, E. (2014), « Physique de la précaution. L’écriture de trois théorèmes primordiaux pour le voir autrement », Revue Environnement et Développement durable, n°12, 2014, p. 17-19.
• Prieur, Met L. Vassalo(2019). « Le principe de non-régression et la biodiversité ? », Revue Juridique de l’Environnemt, 44:499-503.
Article dans une revue électronique
Nom complet, initiales du prénom du premier auteur. & initiale du prénom. nom complet de l’auteur suivant (année). « Titre de l’article », Nom de la revue en italique, URL :
- Laffaille, F. (2019). « Le droit au bonheur animalier –L’ours, l’Habeas Corpus et la Constitution écocentrique », Revue Juridique du Bonheur, http://www.oib-france.com/la-revue-juridique-du-bonheu/le-droit-au-bonheur-animalier, n° 1.
3.3. LES CHAPITRES D’OUVRAGE
Nom complet, initiales du prénom du premier auteur. & initiale du prénom. nom complet de l’auteur suivant (année). « Titre de l’article », dans initiales et nom du ou des directeurs de l’ouvrage (dir.), Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Editeur, Collection.
- Nicolas, G. (2016). « Lois du pays en matière de santé publique : une compétence à conquérir » in David, C. (dir.), Quinze ans de lois du pays, Aix-en-Provence, Ed. PUAM, 209-216.
3.4. LES DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT (TABLEAUX,IMAGES,PHOTOGRAPHIES...)
Tous les documents d’accompagnement doivent être numérotés et appelés dans le texte. Leur localisation exacte au sein du texte doit être précisée. Ils doivent être envoyés en format original et leur emplacement doit être précisé dans le texte.Chaque document doit être accompagné :
- d’un titre concis ;
- du (des) nom(s) de leur(s) auteur(s) ;
- des sources (nom de famille de l’auteur, initiale du prénom, année de publication et page) ;
- Légende s’il y en a.
Les soumissions qui ne respecteront pas les normes définies ci-dessus seront renvoyées à leur auteur sans avoir été soumis à évaluation.
Revue Juridique du Bonheur n° 2025/7
Appel à contributions
Droit au bonheur et Vulnérabilités
Pour son prochain numéro, la Revue Juridique du Bonheur invite les chercheurs, universitaires et praticiens à soumettre un article pour son prochain numéro dont le dossier thématique sera consacré au thème "Droit au bonheur et Vulnérabilités".
Ce numéro, inscrit dans une approche pluridisciplinaire, met l'accent sur l'articulation entre le droit et les sciences humaines et sociales, englobant des domaines tels que les sciences politiques, la sociologie, l'économie, la philosophie, la psychologie, l'histoire ou encore l'anthropologie.
Cette thématique invite à réfléchir sur les interactions entre les fragilités humaines, sociales, environnementales ou institutionnelles et la quête de bien-être ou de bonheur, à la fois dans la théorie et dans les pratiques juridiques. Nous encourageons une réflexion approfondie sur la manière dont ces vulnérabilités façonnent et sont façonnées par le droit, tout en interrogeant les mécanismes juridiques à même de protéger le bonheur individuel et collectif.
Toute contribution sur une autre thématique est également la bienvenue.
Les contributions sont à envoyer au plus tard le 31 janvier 2026 à l'adresse suivante :
rjb@oib-france.com.
Pour plus de détails, voir l'appel à contributions.
Appel à contributions générique
L’Observatoire International du Bonheur (OIB) dont l’objectif principal est de placer au centre de la réflexion le bonheur et les valeurs fondamentales d’humanité,a créé en 2019 la Revue Juridique du Bonheur. Il travaille à la pleine reconnaissance du droit au bonheur, pour l’inscrire dans le paysage scientifique afin d’en accréditer la réalité et la légitimité, pour témoigner de sa vitalité et de l’aspiration des sociétés contemporaines à un renouvellement de la perception du monde.
La Revue Juridique du Bonheur a pour objectif la diffusion de solutions novatrices formulées par les instances internationales, nationales ou locales de par le monde, que ce soit par la voie réglementaire, législative, constitutionnelle, jurisprudentielle, coutumière ou encore sous la forme d’outils de soft law. Par ailleurs, la Revue Juridique du Bonheur souhaite accueillir des contributions théoriques pour participer activement à la construction d’une doctrine juridique du bonheur.
La Revue Juridique du Bonheur a vocation à accueillir toute proposition de publication liée au droit et au bonheur : contribution dans le cadre de dossiers thématiques, contribution sur thématique libre, retours d’expérience, chronique d’actualité législative et/ou jurisprudentielle. Il est également possible de signaler la parution d’ouvrages ou articles en lien avec le droit et le bonheur ou toute actualité législative, constitutionnelle ou jurisprudentielle qui alimentera la mise à jour des sections dédiées du site Internet de la Revue pour offrir aux personnes intéressées par les questions de droit et de bonheur un inventaire complet et actualisé.
Les articles accueillis par la Revue Juridique du Bonheur peuvent être aussi bien rédigés en français qu’en anglais ou en espagnol.
Ces propositions seront soumises à une évaluation anonymisée de deux rapporteurs membres du Comité de rédaction(ou si nécessaire par des experts extérieurs). Un comité de rédaction junior composé de doctorants et jeunes docteurs évalue les contributions des étudiants.
Les consignes éditoriales sont indiquées dans la rubrique "Soumission".
Les propositions sont à envoyer à Carine David, directrice éditoriale, à l’adresse suivante :
Droit au bonheur et Constitutions
Merci de partager avec nous les dispositions constitutionnelles et décisions juridictionnelles consacrant ou mentionnant le droit au bonheur :rjb@oib-france.com
Droit au bonheur et Droit international
Merci de partager avec nous les dispositions ou décisions issues d'organisations internationales ou régionales consacrant ou mentionnant le droit au bonheur :rjb@oib-france.com
Droit au bonheur et politiques publiques
Merci de partager avec nous les dispositifs de politiques publiques nationales ou locales consacrant, mentionnant ou mettant en œuvre le droit au bonheur :rjb@oib-france.com
Droit au bonheur et Soft law
Merci de partager avec nous les dispositifs de toute origine mentionnant ou mettant en œuvre le droit au bonheur :rjb@oib-france.com
Présentation
Septembre 2024, ça y est, la Chronique droit du vivant voit le jour après une longue maturation !

Genèse
L’IDEF, Institut International du droit d’expression et d’inspiration françaises, www.institut-idef.org a mené à bien travail remarquable de compilation et de mise en forme de la jurisprudence comparée en droit des affaires qui a abouti à la rédaction du Code annoté de l’OHADA (Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires).
« La jurisprudence comparée permet de mieux comprendre les différences culturelles et les choix politiques qui sous-tendent les décisions de justice.
Elle contribue également au développement et à l’harmonisation du droit international. » www.institut-idef.org/jurisprudences-compar%C3%A9es
L’association IDEF India, section indienne de cet Institut international, convaincue que ce travail doit être considéré comme un précurseur d’une tâche de coopération plus vaste entre juristes du monde entier, a décidé de travailler sur un autre domaine, le droit des affaires étant traité. Le choix s’est rapidement porté sur les « droits de l’homme ».
C’est là que la spécificité indienne est entrée en jeu. « Pourquoi seulement les hommes ? C’est une vision étroite et restrictive, anthropocentrée » a objecté Reena Iswariya, membre du bureau. Il a donc été décidé de travailler sur le droit du vivant.
Travaux préparatoires
Mais voilà que se sont posées plusieurs questions : Comment faire un code annoté dans ce contexte ? Il n’existe pas de texte ou de principe de droit de référence auquel les juristes d’au moins une partie du monde puisse se référer. Autant l’accord sur la chose et le prix peuvent fonder un contrat est une règle qui peut certes trouver des déclinaisons, mais reste une référence, autant le droit du vivant est trop nouveau pour que ce format puisse être retenu.
Nous nous sommes ensuite interrogés pour savoir ce que l’on entend par vivant.
Clara Guertin, alors stagiaire de l’EFB, a travaillé sur la question et une session de travail, en mode intelligence collective, a été organisée à Pondichéry le 13.11.2017.
Il en est ressorti que les différences culturelles étaient fondamentales dans la pluralité des définitions à retenir, car la notion de frontière est beaucoup plus souple pour les indiens, y compris les juristes. Ainsi, par exemple, à la question une personne décédée peut-elle entrer dans le champ du vivant ? Les français ont répondu « clairement non ! » et les indiens « ils sont vivants autrement ».
Cet atelier ayant ouvert plus de questions qu’il n’apportait de réponse, les réflexions ont pris le temps nécessaire à la maturation. Un format « les grands arrêts du droit du vivant » a été envisagé, puis abandonné car il ne couvrirait que le champ de la jurisprudence et du contentieux et laisserait de côté les textes de loi et les règlementations locales, comme la doctrine.
C’est ainsi qu’après moultes réflexions, sont nées les Chroniques du droit du vivant.
Restait à trouver un capitaine pour mener cette nouvelle barque sur des flots incertains, comme l’a fait le Professeur Mercadal pour le code annoté de l’OHADA et un cadre pour la publication.
Le Lancement des Chroniques
Le cadre
Des convergences existant avec les travaux et réflexions de l’Observatoire international du bonheur, Dont la Revue juridique du bonheur, Revue juridique du bonheur, d’abord bilingue, puis trilingue, a été mise en ligne en 2019.
De manière unanime, les membres des Conseils d’administration des deux institutions ont décidé que c’est dans le cadre de cette Revue internationale qu’en partenariat, elles développeraient et alimenteraient ces Chroniques.
La locomotive…

…car il en faut toujours une, c’est Victor David en synergie avec les membres du Comité scientifique et les membres d’IDEF India, institution dont il fait également partie. Ses compétences et son domaine de recherche l’ont tout naturellement désigné pour cela.
Short biography
Born and raised in Pondicherry, Victor DAVID holds a doctorate in law and social sciences from the Université de Paris Sciences et Lettres/EHESS. He is a Research Fellow at the Institut de Recherche pour le Développement (IRD) and a Member of the Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie (IMBE). He is based in Marseille at the Faculty of Pharmacy at La Timone.
He studied law, political science and British language and civilisation at the University of Paris X Nanterre.
His current research activities and expertise focus on developments in environmental law, and he is a recognised specialist in the Rights of Nature field in France. His research also focuses on environmental health issues. Having lived for 20 years in New Caledonia, he is also interested in the rights of indigenous populations and in contexts of cultural and legal pluralism
As part of its Voluntary Commitments to the United Nations Conference on the Oceans, Victor is also the IRD’s project leader for a feasibility study on the recognition of the, the Mediterranean Sea (2022 - #OceanAction46735) as a natural legal entity, with the MerMéd Project.
Since December 2022 he has been a member of the IUCN World Commission on Environmental Law (WCEL).
Jurisprudence et Contentieux
En septembre 2024, l’organisation des chefs du Sud de la province de Manitoba au Canada a saisi la Cour du Banc du Roi du Manitoba, avec l’aide du Centre juridique d’intérêt public et de First Peoples Law à Vancouver, pour obtenir une déclaration selon laquelle le lac Winnipeg a des droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne en vertu de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Au banc des accusés, le gouvernement du Manitoba et Manitoba Hydro à qui il est reproché d’avoir contrôlé artificiellement et sans étude d’impact environnemental préalable, les niveaux d’eau et le débit de l’écoulement du lac Winnipeg pendant des décennies, ce qui a été « complètement négligent » et a eu des effets "désastreux" sur le lac selon le porte-parole des Chefs, Jerry Daniels. De manière intéressante, celui souligne le lien entre santé environnementale et droits humains des premières Nations : « C’est tout simplement irresponsable. Les zones humides sont en déclin. Les poissons sont malades. Les espèces envahissantes sont arrivées, et les Premières nations se voient refuser leurs droits autochtones inhérents et leurs droits issus des traités », a-t-il déclaré. S’appuyant sur les précédents de la rivière Magpie au Québec et le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande, la requête pour que le tribunal déclare que l’interférence avec les flux naturels du lac sans évaluation environnementale a violé les droits du lac lui-même et des citoyens des Premières nations qui en dépendent a été déposée par un groupe qui se « nomme Nibi Naa da maa geayuk (ceux qui parlent au nom du lac et le protègent) ».
A suivre !
Source presse : https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/southern-chiefs-organization-lake-winnipeg-charter-challenge-1.7328001
Zone : Canada
Dans cette décision de justice, dans une affaire relevant du Dieselgate (voir Aggeri, F., & Saussois, J. M. (2017). La puissance des grandes entreprises mondialisées à l’épreuve du judiciaire : De l’affaire Volkswagen au dieselgate. Revue française de gestion, (8), 83-100.), le tribunal régional d’Erfurt a fait un pas très important dans l’introduction des droits de la Nature pour la première fois en Allemagne. Dans une affaire banale pourrait-on dire de responsabilité du constructeur automobile poursuivi pour dédommagement par un client du fait du trucage du moteur pour le calcul du taux réel de pollution, les conséquences du jugement sur le droit allemand et celui de l’Union Européenne en particulier pourraient ne pas être anodines. Estimant que si la fraude du constructeur automobile Volkswagen doit bien être retenue dans le règlement du litige en tant que tromperie industrielle, le jugement va delà et considère que « [L]’infraction commise par la partie défenderesse a un poids considérable » par les atteintes à l’environnement causées par des émissions de GES non comptabilisées. Ce jugement est en tous cas plein d’audacieuses innovations fondées sur des interprétations inédites par le juge (à commencer par le poids même de cette Charte en droit de l’UE) de différentes dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne dont « découlent les droits propres de la Nature », notamment des articles 2 (droit à la vie), 3 (intégrité de la personne) et 37 (protection de l’environnement). Considérant que la Charte n’est pas à prendre à la lettre mais comme un « instrument vivant » qui « permet de répondre aux nouvelles menaces » comme le changement climatique ou l’érosion de la biodiversité et diverses pollutions, le juge considère le concept de « personne » utilisé dans la Charte comme s’étendant au-delà des sujets humains à ce qu’il appelle les "personnes écologiques", c’est-à-dire les écosystèmes et les entités naturelles qui soutiennent la vie sur Terre ! « La reconnaissance de droits propres à la nature sert » l’objectif essentiel de l’Union décrit à l’article 37 qui est de garantir « un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement doit être intégré dans les politiques de l’Union et assuré selon le principe du développement durable. » Le jugement est particulièrement intéressant en ce qui concerne l’interprétation de l’article 37 qui est plutôt considéré comme imposant des obligations aux États, car il reconnaît aux écosystèmes eux-mêmes des droits.
Nul doute que ce jugement fera date, surtout s’il est confirmé par des cours de niveau supérieur et on espère que d’autres cours de justice à travers l’Union Européenne s’en inspireront pour faire progresser le droit du Vivant sur le Vieux Continent.
Zone : Allemagne – Union Européenne
[Versions originale et française du jugement disponible sur demande]
En 2022, l’Espagne était le premier pays de l’Union Européenne, de tradition civiliste à reconnaître, par le biais d’une loi nationale un écosystème en danger, la lagune Mar Menor, comme sujet de droit. La loi 19/2022 avait été contestée par le parti Vox et 50 membres de la Chambre des Députés avaient saisi Tribunal Constitutionnel espagnol.
Le recours de Vox se basait sur différents arguments suivants :
Inconstitutionnalité en matière de compétences : Les opposants estimaient que cette loi portant sur l’environnement ne pouvait pas concerner une portion du territoire national. Ils soutenaient que cette législation nationale aurait dû s’inscrire dans un cadre plus respectueux des prérogatives régionales, notamment en matière de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement (articles 148.1.9 et 149.1.23 de la Constitution). Ils affirmaient dans le recours que la loi 19/2022 "enfreint le système constitutionnel de répartition des compétences entre l’État et les Communautés autonomes" car "l’objet de la loi indique clairement qu’il ne s’agit pas d’une loi cadre de protection de l’environnement applicable à l’ensemble du territoire national et que, par conséquent, il ne reviendrait pas à l’État de l’élaborer".
Il faut rappeler à ce sujet que l’initiative populaire pour la reconnaissance de la Mar Menor auprès de l’assemblée locale avait échoué, conduisant ses porteurs, en particulier la Professeure Teresa Vincente Gimenez, à passer à une initiative auprès du Parlement espagnol à Madrid.
Violation du principe d’égalité : La loi confèrerait des droits subjectifs spécifiques à un écosystème (la Mar Menor) sans que ce mécanisme soit appliqué de manière uniforme à d’autres environnements similaires en Espagne, ce qui pourrait être perçu comme discriminatoire.
Complexité juridique : Pour les opposants à la loi, la création d’une personnalité juridique pour un écosystème posait des questions quant à son application concrète, notamment en matière de gouvernance et de responsabilité juridique. Des critiques, que l’on entend régulièrement dans les contextes de reconnaissance de droits à des éléments de la Nature, avaient également été émises sur la compatibilité de cette mesure avec les cadres existants de protection environnementale, considérés comme suffisants s’ils étaient correctement appliqués.
Dans sa décision rendue publique le 21 novembre 2024, le Tribunal Constitutionnel espagnol a rejeté le recours en estimant la loi qui reconnait la Mar Ménor comme personne juridique ne violait aucune disposition de la Carta Magna. Le Tribunal déclare qu’il « s’agit d’une technique nouvelle dans notre droit de l’environnement, bien qu’elle s’inscrive dans un mouvement international croissant au cours de la dernière décennie, qui promeut la reconnaissance de ce que l’on appelle les droits de la nature. » et que la loi respecte bien le partage de compétences entre État et provinces autonomes. Le Tribunal rappelle une décision précédente de 1995 qui « a reconnu que l’environnement est un "concept essentiellement anthropocentrique", mais a également déclaré qu’il s’agit d’un concept relatif, concret et dynamique. Il est souligné qu’il appartient au législateur de déterminer les techniques appropriées pour mettre en œuvre le principe directeur de l’article 45 de la Constitution, et qu’il a désormais adopté une vision plus écocentrique. Il est également souligné que l’attribution de la personnalité juridique est différente de la personnalité physique, sans porter atteinte à la dignité humaine, et que la Constitution ne réserve pas la protection juridictionnelle effective à un certain type de personne. »
Avec cette décision, le Tribunal Constitutionnel espagnol confirme le statut de sujet de droit accordé par la loi à la lagune Mar Menor et confirme ce faisant la place de pionnière au sein de l’Union Européenne de l’Espagne en matière de reconnaissance de droits de la Nature.
Sur la loi 19/2022, voir : DELZANGLES, Hubert. La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique et de droits à la « Mar Menor ». Une contribution à la réflexion sur les « biens communs environnementaux ? ». Revue juridique de l’environnement, 2023, vol. 48, no HS22, p. 173-182.
SOHNLE, Jochen. La personnalisation juridique de Mar Menor en Espagne–Un premier pas en Europe vers l’émancipation juridico-politique des éléments de la nature. Revue juridique de l’environnement, 2023, p. 271-287.
AVIÑÓ BELENGUER, David. La loi 19/2022 espagnole, au-delà de la personnification de la Mar Menor (région de Murcie, Espagne). Une ouverture vers une action populaire et une responsabilité civile environnementale ? 2024. https://revista-aji.com/la-loi-19-2022-espagnole-au-dela-de-la-personnification-de-la-mar-menor/
YZQUIERDO, Marine. Ils se sont battus pour que la lagune devienne un sujet de droit. DARD/DARD, 2023, vol. 8, no 1, p. 145-155.
Sources : https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2024_115/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20115-2024.pdf
https://murciaplaza.com/el-constitucional-admite-el-recurso-de-vox-para-frenar-la-personalidad-juridica-del-mar-menor
https://murciaplaza.com/el-constitucional-desoye-a-vox-y-respalda-la-ley-que-reconoce-la-personalidad-juridica-del-mar-menor
Zone : Espagne – Union Européenne
Législation/réglementation locale
Début août 2024, la municipalité côtière située dans l’Etat de l’Espirito Santo a adopté une décision qui confère aux vagues situées à l’embouchure du fleuve Doce, qui coule vers la côte atlantique du Brésil, le droit intrinsèque à l’existence, à la régénération et à la restauration.
La présence des vagues est en fait liée au bon fonctionnement écologique du fleuve Doce. Or celui a été gravement affecté lorsque le barrage de Mariana s’est effondré en 2015, ce qui a dévasté la région (19 morts, inondations de villages). La rupture du barrage a libéré 43,7 millions de mètres cubes de résidus miniers dans la rivière Doce (source Wikipedia), et qui ont enseveli le lit du fleuve de sédiments toxiques stockés. Le flux du cours d’eau et la vie aquatique jusqu’à l’embouchure et le littoral ont été profondément affectés au point d’arrêter la dynamique des vagues. De graves inondations en 2022 ont eu pour conséquence de nettoyer le lit du fleuve qui a retrouvé un débit suffisant et ainsi permettre le retour des vagues. C’est l’action menée par des militants environnementaux face aux atteintes environnementales et des surfers qui ont conduit la municipalité à prendre cette délibération qui accorde aux vagues et au fleuve des droits à l’instar de ceux reconnus ailleurs aux éléments de la Nature. En cela, la règlementation de la municipalité de Linhares va au-delà de la décision du gouvernement péruvien d’accorder en 2016 une protection juridique à la fameuse vague Chicama, sur la base d’une loi de 2001 destinée à protéger les spots de surf.
Zone : Amérique Latine
Source presse : https://jack35.fr/2024/09/12/legalement-reconnu-ses-precieuses-vagues-comme-des-etres-vivants-au-bresil/
Ouvrages et Doctrine
Editions de l’AFD.
Fin juillet, l’Agence Française de Développement (AFD) a publié un ouvrage, magnifiquement illustré sur les droits de la Nature. On y trouve un historique du mouvement des droits de la Nature, des case studies sur tous les continents qui témoignent d’initiatives citoyennes en faveur des droits du Vivant, qui aboutissent ou non à leur intégration dans les ordres juridiques des pays concernés. L’intérêt de cet ouvrage, c’est qu’il est le premier sur les droits de la Nature à parler des droits de la Nature comme inséparables des droits humains au développement. A découvrir des articles en dernière partie qui reviennent sur le rôle du modèle économique libéral actuel qui est à l’origine d’une exploitation sans limite de la Nature.
L’ouvrage est disponible en ligne en français, anglais et espagnol à l’URL : https://www.afd.fr/fr/ressources/droits-de-la-nature
Zone : Monde
Contact
Professeure de droit public à Aix Marseille Université, Membre de l'Institut Universitaire de France, directrice éditoriale
Faculté de droit d'Aix Marseille, 3 avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence
rjb@oib-france.com
Docteure en droit public, Aix Marseille Université, responsable éditoriale
Faculté de droit d'Aix Marseille, 3 avenue Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence
rjb@oib-france.com
Crédits
Politiques de publication
Définition éditoriale
Titre : Revue Juridique du Bonheur
ISSN format électronique : 2678-3312
Périodicité : Annuelle
Année de création : 2019
Éditeur : Observatoire International du Bonheur
Politique de droits d'auteur et de diffusion
Publication en libre accès
Politique sur les frais de publication
Frais de publication : non
Frais de soumission : non
Politique d'évaluation
Procédure d'évaluation : évaluation en double aveugle
Adhérer à l'OIB
Vous souhaitez être informé, vous investir ?
Vous pouvez devenir membre de l'OIB
Formulaire en ligne
Formulaire papier
Je participe
Communiquer, c'est précieux !
N'hésitez plus et partagez avec nous vos
remarques !
Nous contacter
Faire un don
Communiquer, c'est précieux !
N'hésitez plus et partagez avec nous vos
remarques !
En savoir plus
Messagerie
Contact OIB
Adresse :
14 Rue Marcel de Serres
34000 Montpellier
France
Email:
contact@oib-france.com




